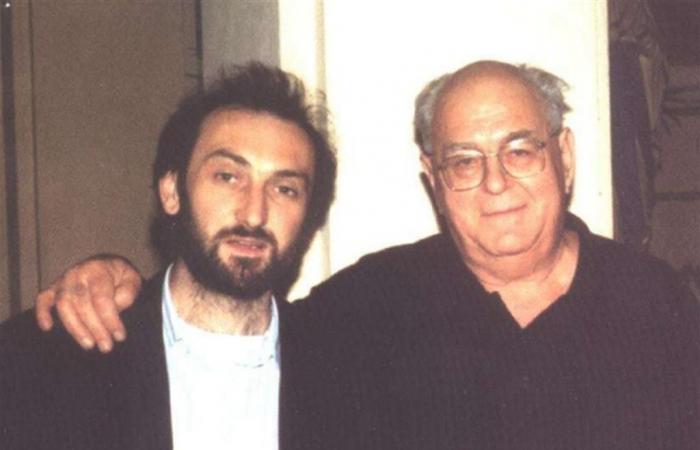
Il ne donnait pas de leçons mais donnait des exemples. Et il a fait grève à rebours. 100 ans après la naissance de Danilo Dolci, l’une des personnalités les plus marquantes dans le domaine de la non-violence et de l’expérience maïeutique, parlons de lui et de son message ensemble Daniele Novara, pédagogue, auteur, conseiller, formateur et directeur du CPP.
100 ans après la naissance de Danilo Dolci, quelle est la pertinence de son message ?
« Pour comprendre sa pertinence, il faut entrer au cœur de son expérience et de ses recherches : la maïeutique, mot grec qui signifie « sage-femme », ou l’art d’accoucher. Pour lui, la maïeutique, c’est libérer des ressources personnelles, sociales, de groupe et communautaires ; sortir de l’auto-référence et avancer ensemble pour se développer et se développer. Il s’agit d’un projet très ambitieux qui combine économie, culture, société, politique et éducation. Un rêve qui entretient encore aujourd’hui de nombreuses aspirations.
Danilo a toujours posé le problème de savoir comment rendre les gens acteurs de leur propre destin, au-delà de toute oppression et de tout mensonge. Une richesse que nous ne pouvons en aucun cas nous permettre de dilapider : sa méthode de travail est un exemple viable d’éducation libératrice.
Pour Danilo Dolci, la politique est l’éducation et l’éducation est la politique, car les conditions préalables à la démocratie sont culturelles et pas seulement institutionnelles. Pour Danilo Dolci, la démocratie se forme d’abord dans la tête des gens. Il définit lui-même les processus de changement social qu’il propose en Sicile dans les années 50 et 60 comme une « croissance collective », la croissance d’un peuple, qui ne peut être imposée d’en haut. Il y a en lui une tension constante pour générer les conditions sociales et politiques qui permettent aux individus de développer une conscience de leur propre valeur, de leur propre pouvoir, du besoin de se faire entendre, de valoriser leur propre existence”.
Don Milani, Danilo Dolci, Bruno Ciari… Ces dernières années, nous avons célébré la naissance de trois grands pédagogues. Y a-t-il un fil conducteur qui traverse les pensées et les actions de ces grands maîtres ?
« L’ensemble du secteur éducatif connaît aujourd’hui de grandes souffrances et non de simples difficultés. Les enfants, les jeunes, les parents, les enseignants et les travailleurs éducatifs se retrouvent dans une situation de forte marginalisation, voire de discrimination. Ce qui manque, c’est un imaginaire commun et collectif qui considère les nouvelles générations comme une ressource et qui guide donc la main des institutions et des politiques pour que les investissements économiques aillent également dans ce sens avec des aires de jeux, des centres de jeux, des écoles maternelles, des formations d’enseignants, une présence pédagogique. dans les écoles, incitations pédagogiques pour les parents.
Il y a lieu d’être nostalgique de chiffres comme Danilo Dolci, Bruno Ciari, Gianni Rodari, Mario Lodi, Alberto Manzi et Don Milani dont la mémoire devrait suggérer que l’engagement éducatif correspond à un véritable engagement pour changer la société. Cette prise de conscience n’existe pas aujourd’hui et le monde de l’enfance, de la jeunesse et de l’éducation est considéré comme un monde secondaire et marginal.
Avec Danilo Dolci et notre Centre nous avons démontré que développer une éducation maïeutique correspond à former des générations de citoyens conscients et responsables, capables de gérer les défis de l’avenir, de sauver la planète, de vivre une citoyenneté qui sait faire de l’hospitalité l’un de ses moments. privilégiés, recherchent l’alternative à une économie d’exploitation exclusive de la nature et des individus.
« ‘Tout le monde ne grandit que s’il est rêvé’, lit-on dans un vers de l’un des poèmes les plus célèbres de Danilo Dolci, héritage de cette grande figure qui nous guide dans notre action et dans notre espérance ».
Danilo Dolci était surnommé de son vivant le Gandhi italien, qu’en pensez-vous ?
« Danilo Dolci, dans l’histoire italienne, est une figure centrale liée à la renaissance après la Seconde Guerre mondiale, notamment après le fascisme.. L’Italie, dans les années 1950, était un pays qui avait subi une véritable violation de son histoire millénaire, faite de culture, d’art et d’économie vitale. Il devient le témoin d’une Italie différente, meilleure, qui a combattu et combat la corruption, qui valorise les ressources des individus, qui fait parler et qui crée des liens. Autant de mots clés de son œuvre sociale et éducative.
Il décide de se consacrer à la cause laïque des plus pauvres, des plus négligés et des plus abandonnés de la Sicile occidentale, à l’époque l’un des endroits les plus pauvres et sous-développés de toute l’Europe. Fort de son expérience avec Don Zeno Saltini à Nomadelfia et d’un charisme absolument unique et incontestable, il introduisit en Italie la non-violence de Gandhi. En 1952, pour protester contre la mort de faim d’une petite fille dans la région de Palerme, il met en œuvre la première expérience de jeûne gandhienne en Italie.
Son idée, quelques années plus tard, de la grève inversée, lorsqu’il conduisit un groupe d’agriculteurs siciliens à creuser un terrain pour demander à pouvoir travailler, arguant que c’était le devoir de l’État, conformément à l’article 4. de la Constitution, pour donner à tous cette possibilité.
Danilo se rend compte qu’il doit intervenir dans le système mafieux qui opprime la Sicile et est le premier à dénoncer les niveaux politiques de la mafia, recueillant des témoignages très précis. Comme Gandhi en Inde, Dolci s’y est opposé de toutes les manières, au point de le pousser à se retirer de la scène publique pour se consacrer exclusivement à l’éducation avec la création du Centre Éducatif Mirto, près de Partinico”.
À votre avis, pourquoi la figure de Danilo Dolci est-elle encore cantonnée à une niche, par rapport aux grands et plus célèbres pédagogues italiens ?
“Danilo Dolci n’est pas un théoricien de la pédagogie ou de l’éducation. C’est un éducateur qui entremêle constamment, comme tous les grands éducateurs depuis Pestalozzi, action et réflexion. Chacune de ses réflexions est absolument contingente à une action, elle ne peut exister indépendamment d’une intervention directe, d’une tentative de greffer les raisons du changement et de la transformation dans la réalité. De ce point de vue, il n’y a pas de noyau épistémologique pur du point de vue pédagogique dans l’expérience de Danilo Dolci, une expérience très éclectique comme on le sait.
Danilo est né avant tout comme poète, matériaux qu’il gardera en réserve pendant plusieurs années pour se consacrer activement à l’intervention sociale. Mais Danilo Dolci est aussi un éducateur : le même engagement social l’amène au domaine de l’éducation au sens strict.
Il est né poète, a travaillé comme animateur social et est mort comme éducateur. Cependant, ces trois composantes sont des passages unitaires de sa vie, il n’y a pas de distinction substantielle entre elles.
S’il existe une métaphore qui peut caractériser l’expérience pédagogique de Danilo Dolci est sans doute la métaphore de la question. Nous pouvons le définir comme l’éducateur de la question, c’est-à-dire l’éducateur qui fonde toute son action éducative sur le questionnement, l’exploration, la création, le questionnement, évidemment non pas au sens scolaire, mais au sens de fouiller, d’aller au-delà de l’apparent, en essayant de découvrir “l’inconnu”, ce qui est voilé par les traditions, les coutumes, les stéréotypes”.
En Europe et dans le monde, il semble qu’il n’y ait plus de place pour une pensée de paix. Pourquoi, selon vous, est-il encore plus important de faire connaître la pensée de Danilo Dolci ?
«Je ne serais pas si catastrophique. Dans l’ensemble, l’opinion publique, tant italienne qu’européenne, est orientée vers la valeur de la paix. Nous avons une Constitution résolument pacifiste en Italie. L’article 11 dit sans ambages : l’Italie rejette la guerre comme moyen de résoudre les différends internationaux. Sans doute, depuis l’invasion de l’Ukraine par la Russie et le début de cette guerre très tragique qui a déjà fait des centaines de milliers de morts sur le terrain, le langage militaire règne à nouveau en maître comme si s’était opéré un voyage dans le temps qui nous ramènerait au monde. Seconde Guerre. L’idée de l’ennemi, l’appel à la victoire, à l’héroïsme… Des concepts tout simplement glaçants et époustouflants, sachant qu’à la fin des années 1940, avant Danilo Dolci, Gandhi avait réussi à libérer l’Inde sans violence. Nous avons eu Nelson Mandela et Martin Luther King. Comme l’a dit le Pape, les intérêts économiques sont énormes : si les armes ne sont pas utilisées, elles ne peuvent pas être produites. Nous sommes toujours coincés dans le jeu de l’offre et de la demande. Les marchés boursiers rapportent que les actions des fabricants d’armes ont grimpé en flèche.
L’opinion publique doit concrètement s’opposer à tout cela par des marches, des manifestations et des initiatives. C’est l’un des grands héritages de Danilo Dolci qui, au moment de la guerre du Vietnam, a organisé une marche pour la paix qui a traversé toute l’Italie, suivie d’une autre en Sicile après le tremblement de terre de Belice lorsque l’État n’est pas intervenu en faveur de la reconstruction. Nous devons faire un effort pour transmettre ces grandes figures aux nouvelles générations car la paix est une valeur, avant même l’environnement. Il n’y aura aucune amélioration du changement climatique si la guerre devient endémique. Nous devons pousser les hommes politiques italiens à se souvenir de Danilo Dolci, Aldo Capitini, Don Lorenzo Milani avec son « L’obéissance n’est plus une vertu ».[1] La non-violence, comme on nous l’a appris, est également la méthode la plus efficace pour gérer une éventuelle invasion ennemie, car elle crée les conditions pour qu’un éventuel envahisseur se retrouve sans terrain sous ses pieds. À l’inverse, entrer dans un conflit armé ne fait qu’alimenter sa propre culture. L’erreur commise par l’Ukraine est la même que celle commise par Israël en réagissant de manière si dramatique après le meurtre de mille quatre cents personnes le 7 octobre. La même chose que les États-Unis ont fait avec l’invasion de l’Afghanistan après les Twin Towers. Des initiatives qui n’ont d’autre effet que de laisser une traînée de morts et d’enrichir les vendeurs d’armes.”
Si lal’œil n’est pas exercé, il ne voit pas,
une peau qui ne touche pas, ne sait pas,
si le sang n’imagine pas, il s’éteint.[2]
[1] L. Milani, L’obéissance n’est plus une vertuLibreria Editrice Fiorentina, Florence, 1965
[2] D. Dolci, Le citron lunaire, dans Créature des créatures, Corbo e Fiori Editori, Venise 1983.
© TOUS DROITS RÉSERVÉS



