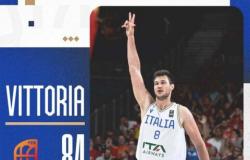L’or de la forêt. C’est ainsi que Paola Barducci, alias “Forestpaola”, la définit, médecin forestier, guide local et vulgarisateur toscan mais qui vit depuis des années dans la vallée de Mòcheni, dans le Trentin. Désigne la résine de mélèzeun produit forestier inconnu de la plupart des gens aujourd’hui, mais encore extrait il y a quelques décennies selon une méthode traditionnelle qui implique la création d’un trou profond à la base des plantes choisies. Une technique connue et pratiquée depuis au moins 500 ans, qui risque aujourd’hui de se perdre totalement dans les profondeurs de la modernité..
Pendant longtemps, Paola a observé et étudié les mélèzes des bois dans lesquels elle vit et travaille, puis, il y a quatre ans, après le feu vert de la municipalité de Palù, elle a obtenu l’autorisation de reprendre l’activité de collecte de résine d’une partie de la commune forestière de Pergine Valsugana. Ainsi, en collaboration avec un gardien local de cette technique ancienne, est lui-même devenu un grand formatou une machine à résine de mélèze. Non pas pour commercialiser le produit, mais uniquement par passion, dans le but de préserver un morceau important de la mémoire collective. Parce que la mémoire, comme l’écrit Paola sur son compte Instagram : « C’est comme la racine d’un arbre : nous devons créer les meilleures conditions pour qu’il continue à croître et à se connecter au monde.».
Il y a quelques jours, il a publié un bobine dans lequel elle montre l’activité de résinage réalisée au printemps de cette année et nous en avons profité pour lui poser quelques questions.
Pouvez-vous nous décrire ce que cela a été de rencontrer la pratique de la résinage du mélèze ? Comment avez-vous remarqué la présence d’arbres autrefois recouverts de résine et qu’est-ce qui vous a alors poussé à approfondir l’histoire derrière ces trous au pied des arbres ?
Depuis des années, je me promène dans les bois du Trentin, par travail de médecin forestier et par passion. À plusieurs reprises, j’ai trouvé ces étranges bouchons à la base de mélèzes de diamètre moyen-grand, et de mon passé universitaire, une leçon du légendaire professeur m’est revenue à l’esprit. Piussi, qui nous a expliqué les produits “secondaires” de la forêt, celles désormais liées à des traditions du passé et peut-être en partie oubliées. Et cela me paraissait vraiment dommage que cet usage, bien que désormais marginal, soit complètement ignoré par les gens, ceux qui vivent en montagne, mais aussi ceux qui vont dans les bois le week-end pour se détendre : au fil du temps, en fait, nous avons relégué la forêt à la seule fonction touristique et récréative, alors qu’elle remplit encore, souvent silencieusement pour la plupart des gens, de nombreuses fonctions..
J’ai donc commencé à me demander et à poser des questions, aux personnes âgées ou aux gardes forestiers, sur ce qu’était la procédure et si elle pouvait être reproduite, ne serait-ce que dans le seul but d’entretenir l’histoire du territoire.
La rencontre avec Michl, passionné homme large (personne qui extrait la résine de mélèze large justement) m’apprend encore beaucoup sur cette pratique mais aussi sur la forêt et les plantes.
A quoi servait la résine de mélèze ? Comment a-t-il été transformé et utilisé dans les communautés alpines ?
Dans le passé, la résine, appelée « Térébenthine de Venise », était principalement utilisée pour deux usages : un familier, pour fabriquer des onguents et des onguents pour soigner les rhumatismes, les plaies et enlever les éclats de bois ; un disons plus “industriel”, pour fabriquer des vernis, colles et peintures. En effet, grâce à ses propriétés techniques (viscosité, élasticité et durabilité), des peintures ont été créées qui maintiennent la flexibilité du bois.
Enfin, il ne faut pas oublier que la résination permet à la résine de descendre à proximité du trou, évitant ainsi l’accumulation dans de petites poches le long du tronc ; cette pratique améliore donc la qualité du bois: certaines scieries traditionnelles le savent très bien, et lorsqu’elles trouvent beaucoup de bois de mélèze dans les zones de résine, elles achètent volontiers ces grumes !
« Il y aura une raison si la résine de mélèze n’est plus utilisée ! » : voilà comment quelqu’un pourrait s’opposer s’il vous voit occupé à insister sur cette technique désormais désaffectée. Pourquoi pensez-vous qu’il est important de maintenir la pratique vivante et, avec elle, le produit qui en résulte ?
Nous sommes désormais habitués à voir la forêt comme un lieu lié à nos promenades et excursions, un lieu de détente ou de pratique d’un sport. Mais la forêt, celle que nous traversons, est ainsi car au fil des siècles elle a été cultivée, coupée, replantée, privilégiant certaines espèces par rapport à d’autres, garantissant sa continuité : chaque arbre pourrait raconter sa propre histoire ! Le hêtre pour son bois tant apprécié pour fabriquer du charbon, l’épicéa pour son bois qui coulait ensuite dans les ruisseaux vers la Sérénissime de Venise, le pin parasol pour son bois parfumé et relaxant et… le mélèze ?
Le mélèze est souvent associé aux pâturages arborés, à ces zones qui, surtout dans le passé, garantissaient la croissance de l’herbe sous la canopée mais en même temps de l’ombre pour le bétail et du bois pour le propriétaire. Néanmoins, tous ces arbres ont des histoires encore plus secrètes, liées à des usages traditionnels aujourd’hui tombés en désuétude.: par exemple, les femmes des vallées descendaient avec de grandes sacoches pour vendre des cônes d’épicéa comme graines pour les futures forêts ou pour allumer des poêles. La résine de mélèze avait ainsi une importance dans la vie quotidienne des familles montagnardes, principalement comme onguent, mais aussi comme chewing-gum ! Pourquoi oublier ces traditions, aplatissant ainsi un thème, la forêt, qui se caractérise au contraire par des bosses et des vallées, de fortes densités et des clairières herbeuses… n’est-il pas peut-être plus enrichissant de raconter et de transmettre toutes ces nuances ?

De nos jours, quelqu’un pourrait penser qu’avec ces trous, “on fait mal à l’arbre”. Vous êtes éducateur environnemental et vous serez certainement habitué à ce type de sensibilité envers la nature. Que répondriez-vous ? (Ou ce à quoi vous avez déjà répondu, si cette question vous est réellement arrivée !)
Oui, on me l’a demandé ! Et à juste titre, sachant que les personnes que j’accompagne ou qui me suivent sur les réseaux sociaux ont généralement une sensibilité particulière aux enjeux environnementaux et au soin et à la protection de la forêt.
Il est vrai qu’un trou est fait, et que cela correspond à une blessure dans la plante, mais contrairement aux blessures normales dont souffre une plante au fil du temps (une pierre qui roule d’en haut, une branche qui se brise, la foudre ou la chute d’un arbre voisin) celui-ci est immédiatement fermé à travers le capuchon, empêchant ainsi efficacement l’entrée d’agents pathogènes, tels que les insectes, les champignons, les virus ou les bactéries. Le capuchon, en effet, est scellé intérieurement avec la résine produite immédiatement par l’usine, bloquant ainsi toute entrée possible d’agents externes.
De plus, ces plantes à résine ne représentent qu’un petit pourcentage du nombre total et chaque année, plusieurs fois au cours des différentes saisons, je hommes larges ils vérifient son statut phytosanitaire, en remplaçant le chapeau ou en observant ses principales caractéristiques comme le feuillage et le tronc : ce sont en fait les plantes les plus contrôlées et aimées par ceux qui vivent dans la forêt, garantissant leur continuité.
Vous êtes une “forêt” – au sens étranger – qui, originaire de Toscane, a choisi de vivre dans une vallée du Trentin, la Valle dei Mòcheni. Redonner vie à cette ancienne tradition était-il aussi une manière de s’enraciner dans cette vallée ? Pour ressentir une petite partie de son histoire ?
Je le dis toujours, je ne m’appelle plus Paola, mais Forêtpaolaparce que je suis médecin forestier et furieux, venant de Toscane. Cette origine est encore forte et tangible dans mon discours, mais mon cœur est désormais entièrement trentin. Ici, je me sens chez moi, ici j’ai construit ma vie professionnelle et personnelle : j’ai en effet décidé d’acheter une maison à Valle dei Mòcheni et de vivre avec ma famille, un mari le plus furieux comme moi et mes deux enfants nés et élevés ici.
Quand je suis arrivé ici, malgré mes études, J’ai appris à regarder la forêt avec des yeux différents, également grâce à la contribution des populations locales et aux livres qui racontent une relation complexe et étroite entre l’homme et la forêt.: on ne parle pas tellement de toutes ces nuances à l’extérieur, préférant les garder en privé ou parfois les oublier. J’ai notamment réalisé que bon nombre des récits de personnes âgées sur l’utilisation de la forêt risquaient de rester dans les mémoires uniquement au sein des familles, et qui sait pour combien de temps. Ainsi, sans vouloir être intrusif mais dans le seul but d’entretenir une trace, un souvenir, Je suis porte-parole des usages anciens (mais aussi actuels) traditionnels, et peut-être non conventionnels, du bois et des plantes en général..
Comme je le dis toujours… Je ne suis qu’un marcheur sur des chemins créés par d’autres: avec mon rythme continu je maintiens sa praticabilité. A vous de décider si vous avez vraiment envie de venir vous promener dans une forêt, en profitant de la complexité des fonctions, des rôles et des usages qu’elle remplit !
Voir cette publication sur Instagram
Un post partagé par Paola Accompagnatrice Trentino (@forest_paola)