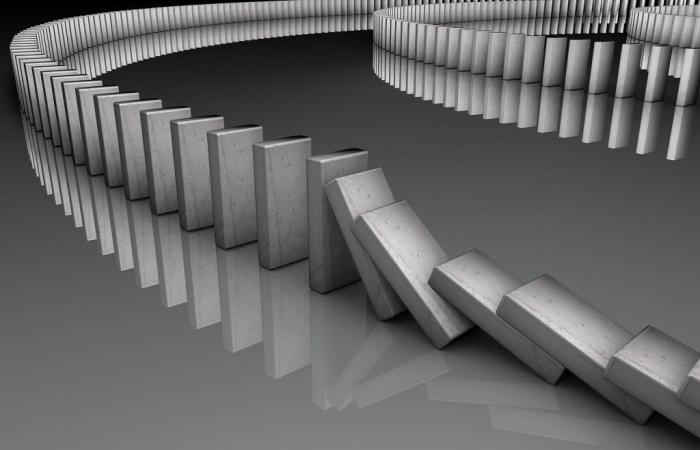
Dans ce cas, la partie adverse n’a pas démontré qu’elle avait acquis le droit au crédit, objet de cet arrêt. En effet, le Tribunal napolitain, partageant l’orientation de la jurisprudence de la légitimité[1]souligne que le le cessionnaire a la charge de déduire et de prouver le contrat sur la base duquel il a acquis la propriété du droit de crédit. La charge de prouver le contrat de cession, en tant que fait constituant le droit au crédit, existe même en l’absence de contestation concrète de la part du débiteur cédé. Il faut observer, sur le plan théorique, en ce qui concerne l’orientation susmentionnée selon laquelle le Tribunal ne doit pas rechercher l’existence de l’acte de cession de crédit en cas de reconnaissance implicite ou explicite de celui-ci par le débiteur :
- Que le fait de ne pas contester spécifiquement l’existence de l’acte de cession est une simple inertie sans valeur significative par rapport à la volonté de la partie de reconnaître le même acte;
- au niveau logique la simple inertie et la reconnaissance implicite ne sont pas superposables;
- sur le plan juridique il n’existe aucune obligation pour la partie de « devoir » se défendre à l’égard d’actes qui ne semblent pas relever de sa sphère de connaissance (qui est l’acte de cession à tenir distinct de la nouvelle de l’acte de cession. Sur ce point, voir ce qui sera dit plus loin).
Toujours à titre préliminaire, le juge constate, sur le plan strictement procédural, que :
- avec l’appel ex 633 cpc, le requérant a déduit sa qualité de créancier et a donc demandé la vérification de la propriété du crédit et non pas simplement la vérification du caractère exécutoire de l’acte de cession au débiteur cédé et de l’existence des conditions d’obtention du paiement « libéré » par le débiteur lui-même ;
- l’acte de cession est un élément qui est inséré dans le raison de demander de la demande de paiement et doit donc faire l’objet d’une allégation et d’une preuve de la part de la personne qui fait valoir le droit au crédit. Il s’ensuit que la question de l’existence de l’acte de cession n’est pas une exception soulevée d’office par le juge, mais relève de la « cible » de la charge de l’allégation et de la preuve du créancier;
- l’acte de cession du crédit relève du pour prouver le thème n’existant pas à son égard, conformément à l’art. 115 cpc, la charge du litige spécifique par le débiteur « cédé ». L’art. 115 cpc en prévoyant la charge du litige spécifique présuppose que la partie ait eu une connaissance immédiate et directe des faits allégués par la contrepartie à l’origine de sa demande, faute de quoi elle devrait être admise, contrairement à la lettre et au ratio de l’art. 115 cit., représenté par le devoir de loyauté procédurale, ainsi que par le principe d’économie du jugement, le litige générique et dilatoire[2].
Dans ce sens, la Cour estime s’en tenir à ce qui a été dit par la Cour de cassation qui, sur ce point, prend une position contrastée par rapport à ce qui a été dit dans la sentence no. 24798/2020, qui exempte l’acte de cession de la charge de la preuve dans la mesure où il n’est pas contesté par le débiteur cédé ou s’il l’a reconnu implicitement ou explicitement. En outre, le Tribunal napolitain estime que l’art. 115 cpc s’applique exclusivement aux faits qui font l’objet de constituant une preuveen tenant compte du fait qu’une lecture cohérente des données réglementaires avec les raisons qui l’inspirent ne peut dispenser la partie qui soutient sa demande en justice de produire des preuves établies, en plaçant cette charge en conformité avec le respect des devoirs de loyauté et de probité procédurale, en évitant les imprudences et des actions inconsidérées et, en outre, le fait de ne pas s’acquitter de cette charge est contraire au principe d’économie de procédure.
La Cour suprême de cassation a elle-même affirmé, en se référant aux preuves préétablies, que pour le fonctionnement du principe de non-contestation il faut que l’existence juridique du document soit pacifique[3]. Cette orientation est cohérente avec ce qui a été souligné dans la littérature, à savoir que le principe dispositif (qui éclaire le procès civil), auquel est également lié le principe de non-contestation, «Cependant, elle ne répond pas exclusivement au caractère privé de l’intérêt protégé dans le procès civil et à une indifférence conséquente de l’État quant à la réalité des hypothèses factuelles de la sentence, mais est principalement déterminée par une intention pratique d’exploiter le initiative des parties pour une position plus rapide et plus sûre du fait conforme à la réalité elle-même : le conflit d’intérêts, qui détermine et anime le processus, permet de croire que le fait passé sous silence par toutes les parties ne peut être et que le fait affirmé par toutes les parties ne peut manquer d’être réel, tandis que la possibilité que cette prédiction soit fausse dans de rares cas ne diminue pas de manière significative la sécurité et l’avantage économique trouvés“.
Le principe dispositif et, par conséquent, la charge de contestation ne représentent pas des moyens de simplifier l’activité procédurale qui expriment une indifférence à l’égard de la vérification de la réalité historique avec pour conséquence qu’« un fait allégué, qui ne s’est jamais réellement produit in rerum natura, ne ne se transforme pas en un événement historique, uniquement parce que l’allégation de son existence devant les tribunaux n’a pas été contestée par ceux qui auraient eu intérêt à la réfuter”.
Eh bien, étant donné que, dans ce cas, le cessionnaire a déposé : un document récapitulatif du contrat de prêt stipulé ; une pluralité d’actes de cession de crédit ; copie des journaux officiels dans lesquels sont publiés les transferts de crédits ; liste des crédits attribués ; considérant également que : l’opposant n’a pas déposé le contrat de financement stipulé par l’opposant, mais seulement le document récapitulatif ; les contrats de cession de crédit ne contiennent pas de critères permettant d’identifier le crédit faisant l’objet de ce jugement parmi ceux transférés ; La publication de l’avis de transfert au Journal officiel est sans importance.
La Cour observe en effet que :
- je 58 BAIGNOIRE dicte le régime de publicité pour la force exécutoire de l’acte de cession et non pour la preuve de la stipulation de l’acte de cession et, donc, de la propriété du crédit cédé;
- la simple publication au Journal Officiel n’est pas pertinente étant donné que l’art. 58 TUB prescrit, aux fins de la force exécutoire de l’acte de cession, la publicité au registre du commerce.. Considérer que la publication au Journal Officiel est suffisante aux fins de la force exécutoire de l’acte de virement entraîne l’abrogation de l’art. 58 co. 2 TUB et la charge pour l’emprunteur de procéder à une vérification constante, par consultation du Journal Officiel, de toute opération de transfert de son crédit;
- l’avis dans la Gazette constituerait une simple indication relative à la preuve de l’existence du contrat de cession, avec pour conséquence une violation des articles. 2721, 2729 cm3 En effet, l’art. 2729 co. 2 cc prévoit que les présomptions ne peuvent être admises dans les cas où la loi exclut le témoignage par témoins. L’art. 2721, alinéa 1er du Code Civil exclut la preuve des termes du contrat lorsque la valeur de l’objet dépasse 2,58 €. L’art. 2721, alinéa 2, du Code civil prévoit que l’autorité judiciaire peut admettre des preuves au-delà de la limite susmentionnée en considérant la qualité des parties, la nature du contrat et toute autre circonstance. Compte tenu de la nature professionnelle de l’intermédiaire de crédit, ce dernier a le devoir d’acquérir et de conserver le contrat : ainsi, la conservation et la production en justice du contrat de cession relèvent des limites de la diligence ordinaire.;
- l’avis au Journal Officiel ne contient pas nécessairement l’indication précise des critères d’identification des crédits couverts par le contrat de mission;
- on ne peut pas considérer que l’avis au Journal Officiel constitue un principe de preuve par écrit au sens de l’art. 2724 cc de manière à permettre l’admissibilité de la preuve testimoniale et donc de présomption étant donné que le principe de la preuve écrite doit être, selon la disposition en question, tout écrit émanant de la personne contre laquelle la demande est dirigée. Dans notre cas, l’avis au Journal Officiel provient de l’intermédiaire qui fait valoir la créance sur la base du contrat de cession.
- Le document intitulé « liste des crédits attribués » n’est pas pertinent.
En conclusion, le Tribunal napolitain ne peut qu’accepter l’opposition, en révoquant l’injonction.
[1] Cfr. Cass. Civ., Sez. III, 13.09.2018, n. 22268; Cass. Civ., Sez. VI, 05.11.2020, n. 24798.
[2] Cf. Cass. n. 3576/2013.
[3] Cfr. Cass. n. 13206/2013.





