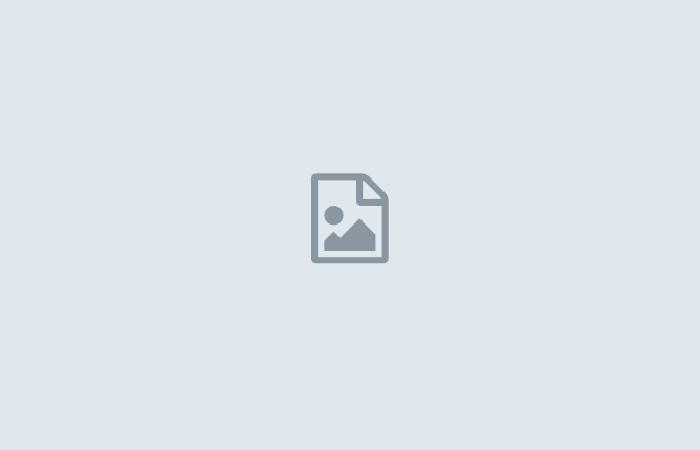Je ne sais pas si tout le monde se souvient du moment où ils ont commencé à perdre leurs dents de lait. Dans ma mémoire, plutôt que la chute elle-même, la sensation qui me vient à l’esprit est celle ressentie lorsque la dent reste à mi-chemin. Comme suspendu à un fil, il se balance d’avant en arrière, laissant dans la bouche un goût de fer qui se mélange à la consistance de la gencive exposée que la langue touche aussitôt. C’est un souvenir ambigu, à mi-chemin entre le sentiment de répulsion provoqué par la découverte d’une partie de son corps restée inédite jusqu’alors et la curiosité de savoir ce qui se cache derrière. Pour certaines personnes, la vue du sang est une torture, pour d’autres c’est une attirance. Ce double sens qui passe entre la familiarité et l’étrangeté que nous ressentons envers ce dont nous sommes faits, dents, os, plaies ouvertes, tissus, est une fine frontière sur laquelle non seulement nous marchons, mais avec laquelle nous jouons souvent. Comme la langue qui pousse une dent sur le point de tomber, s’arrêtant à temps pour l’y laisser ou continuant jusqu’à voir ce qui se passe, une histoire peut aussi être à la fois nauséabonde et attrayante. Dans le cas des films de Yorgos Lanthimos, cette limite est subtile.
Que Les pauvres choses ! Et Le favori Reste à savoir s’ils constituent l’exception dans la filmographie de Lanthimos, car il est encore trop tôt pour la considérer comme complète, et il faut espérer que le réalisateur aura beaucoup à ajouter. Bien sûr cependant Sortes de gentillesseson neuvième long métrage, récemment présenté en avant-première au Cannesquelques mois seulement après la sortie largement acclamée de Les pauvres choses !, marque un retour dans le passé, ne serait-ce que par la collaboration avec Efthymis Filippou, ancien scénariste de Dent de chien, Le homard Et Le sacrifice du cerf sacré. Un retour dans le passé qui s’enrichit d’un casting très actuel, celui composé de son actrice fétiche, Emma Stone, Willem Dafoe, Jesse Plemons, Margaret Qualley, et qui a suscité des réactions plutôt mitigées de la part des critiques.
Si certains ont modifié dans Sortes de gentillesse la brutalité cynique et ironique des premiers Lanthimos, qui ne s’était pas perdue dans les films récents mais qui avait certainement été atténuée au profit d’éléments plus digestes, pour ainsi dire, d’autres ont accusé le réalisateur d’avoir fait un banal exercice de style qui remet en jeu ses anciens thèmes, sans rien y ajouter de nouveau, un maniérisme comme une fin en soi qui fait un clin d’œil à ses fans. Si la vérité est toujours quelque part entre les deux et que les goûts sont les goûts, quels que soient l’enthousiasme et la déception que suscite la sortie d’un film d’un réalisateur très en vue, il faut dire que Sortes de gentillesse fait quelque chose de courageux et d’inhabituel pour le paysage hollywoodien contemporain. Un scénario cinématographique grand public dans lequel il n’y a pratiquement aucun risque de mettre en scène un film qui pourrait être repoussant, ennuyeux ou dérangeant, mais aussi, vu d’un autre point de vue, très captivant.

Sortes de gentillesse il s’agit en fait d’une histoire divisée en trois épisodes où certains des thèmes chers à Lanthimos, les mêmes qui ont fait de lui la pierre angulaire du soi-disant Bizarre vague grecque, reviennent avec force, notamment celles qui s’accompagnent d’une certaine aisance dans la crudité des images. La douleur physique, les mutilations, la mort, le sang, le sexe grotesque, la pulsion animale de l’être humain, mais aussi une dose massive de surréaliste et de mythologique. Le lien entre Lanthimos et le mythe classique a en effet toujours été souligné non seulement par les choix du réalisateur dans ses films, par des citations directes de mythes comme Iphigénie, mais aussi par une forme de continuité avec les éléments structurels narratifs et fonctionnels. de la tragédie grecque.
Dans Sortes de gentillessetous ces ingrédients sont réunis sous l’égide d’un grand thème, qui est celui des relations de pouvoir qui existent entre les êtres humains, poussés à l’extrême par une esthétique volontairement aliénante et onirique, avec des décors qui ne fournissent pas de coordonnées précises de l’espace et du rêve. temps et avec une dilatation des rythmes de l’histoire qui rendent tout étouffé et déformé, également grâce aux excellentes performances des acteurs avec lesquels ce n’est pas un hasard si Lanthimos choisit souvent de travailler et à la bande-son martelante et clairsemée de Jerskin Fendrix.

Dans le premier épisode, intitulé La mort de RFM, acronyme qui reviendra dans les trois titres, le pouvoir se manifeste à travers une sorte de mise en scène de la dialectique serviteur-maître : le protagoniste, apparemment plongé dans une condition de bien-être aristocratique qui le rend libre et épanoui en tant qu’individu. , est en réalité victime du contrôle total de son patron. Lorsqu’il se rend compte que cette condition n’est plus tenable, Robert, joué par Jesse Plemons, se rebelle contre la volonté de Raymond, joué par Willem Dafoe, dans lequel il a besoin du service total de son esclave. Il doit savoir qu’en plus de pouvoir maîtriser sa vie privée sous toutes ses formes, depuis les avortements imposés à son épouse jusqu’au choix de sa femme elle-même jusqu’à l’automutilation, sa domination s’exerce également dans la décision de prendre lui commettre un crime de manière totalement arbitraire. La gentillesse qui donne le titre au film de Lanthimos s’exprime ainsi à travers l’attitude calme, généreuse et paternelle de Robert envers Roger, un type de gentillesse qui cache une dynamique de soumission impitoyable, et la courtoisie de Roger lui-même, qu’il ne parvient pas à émanciper. de son rôle subordonné, même si ce n’est plus ce qu’il souhaite. Une métaphore hyperbolique de la dynamique capitaliste, au sein de laquelle l’interdépendance entre ceux qui commandent et ceux qui sont commandés se confond avec le chantage, le sentiment de culpabilité, la hiérarchie qui s’immisce aussi dans la vie privée du salarié. Un mécanisme que Lanthimos amène à l’exaspération mais qui, de manière plus insidieuse et subtile, mine la vie de quiconque se retrouve dans une condition de travail de subordination à un patron.

Mais dans le deuxième épisode, le pouvoir mis en scène est le pouvoir privé du couple qui se matérialise dans la convention du mariage. Ici, les éléments contrastés typiques du cinéma de Lanthimos sont les protagonistes : RMF voleen fait, est peut-être l’histoire la plus pleine de charnalité et d’obscénité, le summum de la trilogie dans laquelle l’amour et la mort se rencontrent de manière violente et incompréhensible. Jesse Plemons, qui incarne cette fois un policier nommé Daniel, ne comprend pas la disparition de sa femme Liz, Emma Stone, au cours d’une expédition qui se termine par un naufrage. La tragédie de cet événement se superpose à la comédie de moments totalement décalés dans lesquels Daniel est le protagoniste, depuis la demande de revoir les films pornographiques réalisés avec un couple d’amis et Liz dans le salon, pour pleurer son absence, jusqu’à une attitude inappropriée sur le lieu de travail qui le fait passer pour un inadapté aux yeux de tout le monde.

Mais le véritable cœur de l’histoire se révèle lorsque Liz est retrouvée après avoir vécu quelque temps comme une naufragée, se nourrissant uniquement de ce qu’elle a trouvé et vivant immergée dans un état primordial qui la change profondément, au point de faire des allusions troublantes. à un monde dans lequel les chiens sont aux commandes, des animaux plus miséricordieux et plus humains que les humains eux-mêmes : la gentillesse, même dans ce cas, se révèle de manière grotesque. De son changement naît le soupçon maladif de Daniel selon lequel Liz n’est pas vraiment Liz, et avec cela une série d’exigences violentes et brutales pour prouver son identité. Tout ce que le mari demande doit être exécuté par la femme, dans une boucle d’autorité qui devient de la pure cruauté.

Le dernier des trois épisodes, à mon avis le plus réussi, est celui dans lequel la représentation du pouvoir prend corps dans les règles rigides et folles d’une secte, à mi-chemin entre New Age et syncrétismes mystiques, qui interdit à ses adeptes d’avoir des relations. sexuellement avec toute personne autre que les deux chefs spirituels, joués par Willem Dafoe et Hong Chau. RMF mange un sandwich raconte ainsi l’histoire de deux adeptes, Emily et Andrew, Emma Stone et Jesse Plemons, qui doivent retrouver la figure d’une femme qui ressuscite les morts. À bord d’une voiture violette qui fonce à toute vitesse dans les rues de la ville américaine indéterminée qui sert de décor aux trois chapitres, les deux hommes demandent à des filles susceptibles d’avoir un don paranormal de se tester en réveillant des cadavres dans une morgue d’hôpital. Les moments d’échec macabres du duo alternent ainsi avec les visites au siège de la secte, où le sexe se mêle à des rituels bizarres comme boire les larmes de leurs chefs spirituels dans une grande flaque d’eau. Emily, la nouvelle adepte, est très motivée pour gagner l’amour et la confiance des deux dirigeants, ayant complètement mis de côté sa famille et sa vie antérieure au nom de la recherche de l’élue.

Une recherche qui, au moment où elle est expulsée du cercle magique pour « impureté » et pour avoir eu des relations sexuelles hors de la loge, cela se termine bien, dans le plus pur style Lanthimos : deux jumelles, toutes deux interprétées par Margaret Qualley, sont la réponse à la chasse d’Emily, désormais seule dans sa quête d’exilée qui veut regagner la confiance des dirigeants. Mais le détail fondamental est que pour que les miracles se réalisent, il faut que l’une des deux sœurs soit morte. Et encore, des crânes brisés dans une piscine vide, des jambes coupées, des cadavres violets, tout – dans le troisième et dernier épisode de Sortes de gentillesse – est teinté de ces couleurs sanglantes et ironiques typiques de la poétique du réalisateur grec. Et cette fois aussi, la gentillesse, celle d’une femme élue au rôle de réanimatrice, si disponible et polie même envers ceux qui veulent la kidnapper, agit comme un contrepoint surréaliste à la violence du pouvoir exercé sans logique, dans une représentation oxymorique qui le rend encore plus brut et l’histoire est paradoxale.

Comme une dent qui bouge, impossible à ignorer mais en même temps répugnante par ce qu’elle révèle, Sortes de gentillesse c’est un film qui fait se couvrir les yeux devant des scènes révoltantes et en même temps rire d’un cadavre qui se réveille et mange un sandwich en toute simplicité. Le fait que Lanthimos ait choisi de l’amener au cinéma précisément au moment de son plus grand succès commercial laisse espérer qu’il ne sera pas seulement un réalisateur de films à succès, qui est un métier difficile mais dont Hollywood a déjà en abondance, mais un auteur. avec qui il ne renonce pas à son propre style et à ses choix, même lorsque ceux-ci frisent le dérangement. Après tout, comme nous l’enseigne un autre Grec, Aristote, il n’y a pas de catharsis s’il n’y a pas d’abord de conflit.