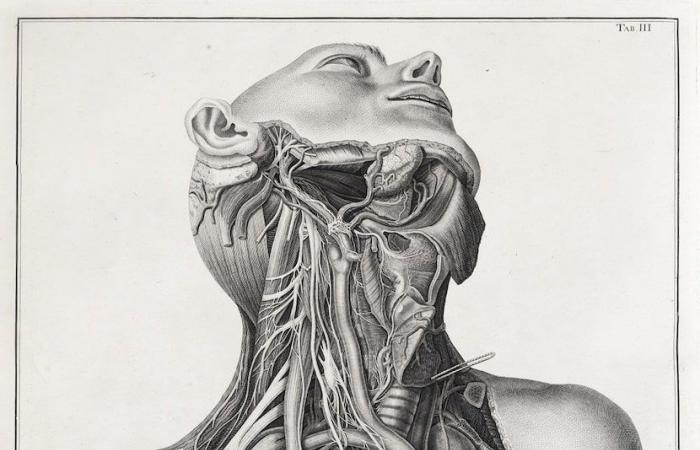L’atlas des poisons de Heinrich Falk, publié en Italie chez Adelphi, plonge dans les méandres les plus sombres de l’âme humaine, transformant en récit des maladies qui ont marqué trois siècles d’histoire. Le roman se situe à mi-chemin entre un thriller de science-fiction et une réflexion philosophique, mettant en scène une épopée qui traverse l’espace et le temps.
Heinrich Falk, né à Berlin en 1968, a étudié la médecine et la psychologie à Heidelberg, où il a développé un intérêt pour l’histoire des maladies et leur interaction avec la société. Après avoir travaillé pendant des années comme psychiatre, Falk a commencé à écrire, inspiré par ses études et son expérience clinique, attirant dès ses débuts une grande attention pour la profondeur et l’originalité de sa pensée. L’atlas des poisons – son quatrième roman – représente le point culminant de sa carrière, une œuvre qui combine les vastes connaissances scientifiques d’un homme dont la sensibilité narrative semble, aujourd’hui, tout aussi rare.
Le langage de Falk est dense, riche en détails, capable d’évoquer avec vivacité l’atmosphère des différents siècles qui constituent la toile de fond du déroulement de l’intrigue. Sa prose est à la fois lyrique et précise, capable de capter à la fois la beauté et l’horreur des contextes décrits. Les protagonistes du roman, dont le médecin et psychiatre Johannes Kremer, sont décrits avec beaucoup de soin, représentant chacun un point de vue singulier sur les époques traversées. Kremer, en particulier, apparaît comme une figure complexe et tridimensionnelle : celle d’un homme tiraillé entre la rigueur scientifique et les implications morales de ses découvertes.
Au XIXe siècle, Falk, parlant de consommation, s’intéresse aux répressions sociales et culturelles de l’époque. La société victorienne, avec ses tabous sexuels rigides et ses normes restrictives, est magistralement évoquée, révélant que la maladie elle-même ne peut pas être considérée comme un fait purement médical, mais aussi en grande partie comme le reflet de l’air du temps de l’époque. Dans cette partie du roman l’auteur reprend les théories de Michel Foucault en citant son célèbre ouvrage, Histoire de la folie à l’époque classique, dédié à l’analyse des relations entre société, mécanismes de contrôle et déviance. Vient ensuite la description de certaines pratiques médicales répandues à l’époque, comme la masturbation thérapeutique pratiquée pour soigner l’hystérie féminine, révélant leurs profondes contradictions et hypocrisies.
Au XXe siècle, l’attention s’est plutôt portée sur le cancer : une maladie que Falk a analysée à travers le langage de la guerre qui imprègne la terminologie médicale. Les métaphores du bombardement des maladies évoquent en fait le travail de Susan Sontag dans La maladie comme métaphoreun essai dans lequel les métaphores de guerre et leurs influences sur la perception et le traitement des maladies sont explorées. Les résultats soulignent comment la vision guerrière du cancer, en plus d’aliéner les patients, reflète également une société obsédée par le contrôle et la victoire.
Dans le troisième acte du roman, nous arrivons au 21e siècle : le moment où nous sommes confrontés à la pandémie de Covid-19 – associée au trouble de la personnalité paranoïaque. À l’ère de l’hyperconnexion, la peur de la contagion a conduit à un isolement paradoxal, dans lequel les relations sociales s’effectuent à travers les écrans et les réseaux numériques. Ce sombre scénario rappelle les théories de Zygmunt Bauman sur la société liquide, dans laquelle les liens humains sont fragiles et transitoires. L’auteur explore comment la paranoïa et l’anxiété collective se sont enracinées dans le tissu social, conduisant à un isolement qui semble refléter les échos du trouble mental susmentionné.
L’atlas des poisons Il s’inscrit donc dans une tradition littéraire qui trouve ses piliers dans des œuvres telles que L’homme sans qualités de Robert Musil, où réflexion et analyse philosophique et psychologique se rejoignent dans une fresque de la condition humaine. Heinrich Falk fait preuve d’une louable maîtrise du sujet, entrelaçant des références à des psychologues et à des psychiatres experts en psychologie dynamique – comme John Bowlby et Donald Winnicott – pour donner vie à un ouvrage qui rend à la fois une enquête historique et une réflexion sur les maladies. d’âme.
Nicolò Locatelli
**
Avec notre aimable autorisation, nous publions un fragment de « L’Atlas des Poisons » de Heinrich Falk
Johannes Kremer était assis au bureau de son bureau, la lumière de la lampe à huile projetant de longues ombres sur les murs. Ses mains, couvertes de gants de cuir, parcouraient les pages jaunies d’un rapport médical du XIXe siècle. Chaque mot semblait murmurer des secrets oubliés, échos d’une époque où la consommation et la tuberculose étaient des démons invisibles qui dévoraient les corps et les âmes.
La société victorienne, après tout, était un labyrinthe de normes rigides et de répression étouffante. Kremer se souvenait clairement, de son dernier voyage, des couloirs et des chambres d’hôpitaux où gisaient des personnages diaphanes et épuisés dans leurs lits.
Une figure en particulier refait souvent surface dans l’esprit de Kremer. Elisabeth, une jeune patiente aux longs cheveux noirs et aux yeux pleins de fièvre brûlante. Elisabeth, qui a avoué à voix basse désirs interdits et rêves brisés, sa respiration difficile marquée par l’évolution de la maladie.
“Docteur”, murmura-t-il, “chaque respiration est un combat.”
Kremer savait que ce n’était pas seulement la bactérie qui la consommait, mais la société même qui l’entourait. Les thérapies de l’époque, souvent rudimentaires et invasives, reflétaient une compréhension limitée de la maladie.
Kremer avait observé ces pratiques avec un mélange d’horreur et de fascination, conscient des profondes contradictions qui les sous-tenaient.
« Elisabeth », a-t-il répondu, « la maladie est le reflet du monde dans lequel vous vivez. »
Les paroles de Kremer étaient empreintes d’une profonde tristesse. Il savait qu’Elisabeth ne comprendrait pas. Il espérait juste lui offrir une certaine forme de réconfort.
« Mais votre souffrance, a-t-il poursuivi, n’est pas vaine. »
Kremer ferma le livre et se dirigea vers la fenêtre. Dehors, le brouillard matinal qui enveloppait les rues de Londres était comme toujours balayé par les SweepBoops du gouvernement. Avec un soupir, il retourna à son bureau. Il ouvrit un nouveau cahier.
« Notre tâche est d’éclairer. Comprendre. Guérir”.