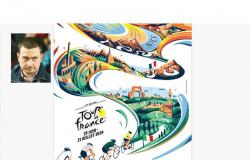Maintenant que le danger des infections au Covid-19 est maîtrisé, même s’il n’est pas totalement vaincu (plus de 3 000 nouveaux cas notifiés ces 30 derniers jours et un nombre non négligeable d’hospitalisations), les virus de la grippe aviaire réapparaissent à l’attention de ceux qui les étudient. l’horizon des éventuelles menaces de pandémie à venir. D’autant que, le 25 mars 2024, des responsables fédéraux du ministère de l’Agriculture des États-Unis ont annoncé avoir identifié une souche hautement pathogène de grippe aviaire chez certaines vaches laitières. Un saut d’espèce important.
Les virus de la grippe sont de grands transformateurs grâce à leur génome divisé en 8 segments, qui codent pour 11 protéines. Lors de la multiplication virale, les segments sont reproduits en de nombreuses copies pour être ensuite assemblés en nouvelles particules virales. Si des virus grippaux d’origines différentes sont présents, les segments peuvent se réassortir différemment des originaux et produire des sous-types et de nouvelles variantes virales, avec des caractéristiques différentes. Forts de ces capacités à produire toujours de nouvelles « formulations », les virus grippaux sont capables d’infecter de nombreuses espèces, des poissons aux mammifères, et de se modifier continuellement.
En particulier pour les virus de type A, deux protéines sont cruciales pour provoquer une infection et une maladie et sont utilisées pour les classer en différents sous-types : l’hémagglutinine (indiquée par l’acronyme H) et la neuraminidase (indiquée par la lettre N). 16 hémagglutinines différentes et 9 neuraminidases différentes ont été identifiées. L’hémagglutinine est responsable de l’adhésion des particules virales aux récepteurs cellulaires d’hôtes spécifiques et explique ainsi pourquoi chaque sous-type n’est capable d’infecter que certaines espèces. La neuraminidase, quant à elle, est une enzyme nécessaire pour libérer, après leur multiplication, les particules virales dans l’organisme infecté. Les médicaments antiviraux de choix (comme l’oseltamivir) sont des inhibiteurs de la neuraminidase qui bloquent la libération des particules virales et réduisent donc la charge virale et la contagiosité des personnes infectées.
Seuls les sous-types H1, H2, H3, appariés dans trois des 144 combinaisons possibles de N1 ou N2, sont adaptés pour infecter l’espèce humaine et sont responsables d’épidémies saisonnières. Jusqu’à présent, la situation a été tellement étudiée et consolidée que chaque année, des « prévisions » sont faites sur les sous-types qui circuleront au cours de la saison suivante et des vaccins saisonniers sont formulés sur la base de ces projections. Cette année également, en février, l’OMS a recommandé la nouvelle composition vaccinale pour la saison 2024/2025, énumérant les souches virales à inclure dans la mise à jour de la formulation quadrivalente et trivalente et la circulaire ministérielle de protection contre la grippe à partir de l’automne prochain. Les vaccinations induisent une réponse immunitaire contre des sous-types particuliers de H et N et, répétées chaque année, élargissent la protection.
Même si la situation de la grippe saisonnière semble sous contrôle, il existe toujours un risque d’incursions de nouveaux variants et de virus A provenant d’autres espèces, le fameux « spillover ». En fait, nous n’avons toujours pas élucidé l’origine de la pandémie de Covid-19, mais l’idée qu’un virus de la grippe « saute » d’une espèce à une autre ne nous semble plus invraisemblable. Nous savons que les oiseaux sauvages sont le réservoir naturel des virus de la grippe aviaire, nous savons que beaucoup de ces virus sont hautement pathogènes pour les animaux qu’ils infectent et ont une létalité élevée ; nous soupçonnons que le virus à l’origine de la terrible « grippe espagnole » possédait des gènes d’origine aviaire.
Avec ces éléments disponibles et face à l’expansion continue de la grippe aviaire, il est nécessaire de maintenir un niveau élevé d’attention et de disposer de bons systèmes de surveillance et de réponse.
Parmi les virus aviaires, le sous-type H5N1 est celui qui a été identifié le plus longtemps comme candidat potentiel au passage de l’espèce à l’humain. Les premiers cas d’infection humaine ont été identifiés en 1997 à Hong Kong. De 2003 au 27 novembre 2023, un total de 882 cas humains d’infection par la grippe A(H5N1), dont 461 décès, ont été signalés dans le monde dans 23 pays. Presque tous les cas d’infection humaine par la grippe aviaire A(H5N1) ont été classés comme sporadiques et liés à un contact étroit avec des oiseaux infectés vivants ou morts ou avec des environnements contaminés par le virus. En 2020, une souche H5N1 (2.3.4 4b) hautement pathogène pour les oiseaux, différente de celles qui circulaient auparavant, a commencé à se propager avec les oiseaux migrateurs dans de nombreuses régions d’Afrique, d’Asie et d’Europe, provoquant une mortalité importante d’oiseaux. En 2021, les mêmes virus sont passés en Amérique du Nord et en 2022 en Amérique du Sud.
Le document conjoint FAO-OMS du 23 avril 2024 rapporte qu’entre-temps, la fréquence des déclarations d’infections chez les animaux marins et terrestres autres que les oiseaux, y compris certains mammifères et animaux domestiques, a augmenté. Des foyers épidémiques ont été signalés chez des animaux à fourrure en Finlande et en Espagne, confirmant la possibilité de contagion entre mammifères. Aux États-Unis, des infections ont été constatées chez des chèvres et des vaches laitières et la souche H5N1 (2.3.4 4b) a été identifiée dans la majorité des cas. Enfin, toujours aux USA, l’événement le plus sensationnel en raison de sa multitude : des cas d’infections à H5N1 chez des bovins laitiers appartenant à 67 élevages différents dans 9 États différents et des concentrations virales élevées (même supérieures à celles trouvées dans le système respiratoire) ont été détecté dans le lait produit.
Les modes de propagation de l’infection parmi les bovins n’ont pas encore été clarifiés, mais la capacité des virus à infecter les mammifères est claire, démontrant la transmission des oiseaux aux bovins. Des recherches, non encore vérifiées, suggèrent la susceptibilité des bovins en raison d’une présence abondante, dans les glandes mammaires, de récepteurs cellulaires propices à l’infection.
La bonne nouvelle est qu’il ne semble pas encore que les virus soient capables de se transmettre par contagion directe d’un animal à un autre : il manque donc un des éléments nécessaires au déclenchement d’une épidémie même chez les animaux, alors que l’on soupçonne que des infections se sont propagées. par contamination mécanique pendant la traite.
Pour l’instant, la réponse de santé publique aux États-Unis s’est concentrée sur la limitation des infections parmi les troupeaux de bovins et sur la surveillance des travailleurs exposés à des animaux infectés. Une ordonnance fédérale exige que tous les bovins laitiers soient testés pour l’infection H5N1 avant le transfert interétatique et mis en quarantaine pendant 30 jours à leur arrivée.
Compte tenu du manque de preuves sur la manière dont les bovins sont infectés, l’un des points critiques soulevés est le manque d’indications claires sur la manière de gérer les troupeaux après la quarantaine. Le personnel travaillant en contact avec des animaux doit être surveillé pour identifier les cas d’infection, mais la présence de travailleurs illégaux ne facilite pas le processus. De plus, une pénurie d’épidémiologistes de santé publique et un manque de financement dédié sont cités dans une enquête du CDC comme des obstacles à la surveillance du personnel exposé. Les activités de surveillance sur environ 350 personnes ont jusqu’à présent identifié 3 cas d’infection chez des travailleurs en contact avec des bovins infectés dans deux États différents. Les tableaux cliniques observés chez les trois personnes infectées étaient légers (conjonctivite et dans un cas toux) et seraient certainement passés inaperçus sans une surveillance attentive.
Les évaluations du risque d’infection pour la population générale par l’OMS, le CDC et l’ECDC indiquent un risque très faible. La présence éventuelle de virus dans le lait de vache est éliminée par la pasteurisation, il n’y a donc aucune raison d’inquiéter la santé des personnes. Ce qui se passe, cependant, est une nouvelle occasion de nous rappeler que la santé humaine, animale et environnementale sont inextricablement liées et que seule la santé publique peut mettre en œuvre des systèmes de surveillance et de réponse efficaces, tout en évitant les alarmismes inutiles.