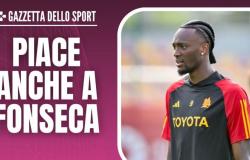Ce sont les gars avec des visages qui parlent. Il raconte d’autres origines dans un passé récent ou lointain et les compare « effrontément » aux thèmes de l’appartenance, de l’identité, du racisme. De la maturité ou non de la société italienne face à sa jeune histoire. De ne ressentir ni viande ici, ni poisson là, là où les portent encore les liens familiaux et un morceau de patrimoine culturel.
L’étude “Négocier les frontières et revendiquer l’appartenance dans l’interaction quotidienne” du Département de Droit et d’Etudes Politiques et Internationales de l’Université de Parme. Il s’agit d’un projet de trois ans financé par la Commission européenne, Next Generation Fund, par le Mur avec le Pnrr, et comparera la réalité de Parme et celle de Grande-Bretagne grâce à la collaboration avec l’Université de Saint Andrews en Écosse.
Au cours de ces premiers mois, les chercheurs de notre université Annavittoria Sarli, propriétaire du projet, Kombola T-Ramadhani-Mussa et Mackda Gebremariam Tesfaù ont organisé des groupes de discussion dans les instituts Bodoni et Ipsia, où les participants de différentes classes se sont réunis dans une comparaison ouverte des des expériences et des expériences, timides au début mais avec une fin toujours vivante. Une rencontre impliquait les étudiants du lycée des Sciences Humaines de Sanvitale, une autre la jeune génération qui fréquente le temple sikh.
Les voix des enfants ont été enregistrées et deviennent une expérience de théâtre forum avec la coopérative Giolli et l’actrice Gaja Ikeagwuana : en mettant en scène des histoires quotidiennes de racisme, d’exclusion, d’altérité, de discrimination, elles permettront au public d’autres écoles de Parme d’interagir vivre en insérant de nouveaux éléments à chaque fois. Et faire circuler le sentiment d’exclusion ou d’accueil, le poids des préjugés et la légèreté de la rencontre de la diversité. Pour en faire quelque chose de transformateur et de positif.
«Aujourd’hui, dans notre pays, de nombreuses personnes présentent des caractéristiques phénotypiques différentes et appartiennent, au niveau ethnique et culturel, à des groupes de plus en plus diversifiés. Mais le récit de ce qu’est l’italianité semble rester inchangé, même sur le plan juridique”, expliquent les chercheurs. Face aux épisodes de racisme que – sans exception – les étudiants ont vécus, il y a ceux qui décrivent la colère et ceux qui tentent d’engager une discussion constructive, ceux qui sont plus détachés et qui en rient. «Mais même ceux qui parlaient avec ironie des épisodes qu’ils avaient vécus étaient au contraire émus par la discrimination subie par leurs parents – soulignent-ils -. S’ils sont plus conscients et exigeants, les pères et les mères sont souvent plus silencieux et nous demandent de rester calmes pour ne pas être du mauvais côté et se retrouver dans des ennuis. En ce sens, les enfants vivent ces situations comme une grande injustice, pensant à la moindre capacité de réaction des parents en raison du problème de langue et parfois du manque de citoyenneté.”
Le constat d’une large diffusion des épisodes racistes a été (malheureusement) pris en compte, mais des aspects inattendus apparaissent même pour ceux qui sont impliqués depuis un certain temps dans les études sur la migration. «Il est intéressant d’entendre qu’il y a des endroits précis où cela se produit – commente Ramadhani-Mussa – : le bus surtout. Mais même l’école n’est pas un lieu neutre. S’il y a des enseignants qui promeuvent l’intégration et la valeur des différences, d’autres émergent d’histoires nettement racistes, ou dans certains cas inexistantes, restant en retrait au lieu d’intervenir face aux faits ou aux mots.
Et restant sur le thème des mots, ils invoquent « la banalité des préjugés bienveillants, qui ont des conséquences très néfastes ». Des phrases comme “Si même elle l’avait compris…” ou l’étonnement face aux notes élevées ou “encore” meilleures que la classe. «Parfois, les étudiants finissent par se contenter de la place assignée par le stéréotype, renonçant à faire des efforts – souligne Sarli -. Tout comme le fait de ne pas se sentir accepté conduit à une relation avec l’Italie dans laquelle « Tu ne veux pas de moi ? Alors c’est moi qui ne veux pas de toi » : c’est pourquoi plusieurs d’entre eux déclarent appartenir au pays d’origine de leurs parents. La bonne nouvelle, c’est qu'”ils ont néanmoins de l’espoir : non pas dans les adultes, en qui ils ont peu de confiance, mais dans leurs pairs avec qui il existe un dialogue franc, plus ou moins conflictuel”. Ce qui peut vous aider à vraiment vous reconnaître.
Chiara Cacciani